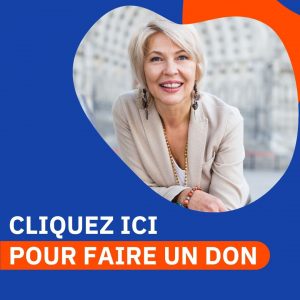Retour sur la Journée MICI et environnement
Vendredi 10 janvier, l’association afa Crohn RCH France organisait pour la première fois une grande journée de recherche dédiée aux liens entre les MICI et l’environnement. Une journée réunissant plus de 150 personnes, en majorité des chercheurs, mais également des malades et des proches, au Ministère de la Santé.
Découvrez les replays des conférences à la fin de cet article !
Plusieurs experts, cliniciens, chercheurs, ont partagé leurs connaissances sur le rôle des facteurs environnementaux dans le déclenchement et l’aggravation des MICI, des maladies qui « explosent » dans les pays occidentaux, et qui augmentent dans les pays en cours d’industrialisation, à tel point que nous parlons désormais d’épidémie. En France, plus de 300 000 personnes en sont atteintes, dont 10% sont des enfants et adolescents. D’ici 2030, 400 000 personnes devraient être concernées.
Parmi ces facteurs environnementaux, le tabac, l’anxiété, la sédentarité mais aussi et surtout l’alimentation ultra-transformée : des additifs alimentaires et émulsifiants sont responsables de l’appauvrissement et de la détérioration du microbiote intestinal (anciennement flore intestinale), et sont des facteurs d’inflammation de la paroi intestinale.
Les polluants, les métaux lourds, les PFAS, les micro-plastiques, les pesticides aussi sont activement étudiés, notamment leur corrélation géographique, le Nord de la France, en particulier les zones d’agriculture intensive, étant particulièrement concerné par ces maladies.
QUELS ETAIENT LES OBJECTIFS DE CETTE JOURNEE DE RECHERCHE ?
Déjà le partage des connaissances et des dernières données sur le rôle des facteurs environnementaux dans les MICI et d’autres maladies inflammatoires chroniques (notamment la polyarthrite rhumatoïde), mais aussi les partages d’expériences et méthodes de recherche, les perspectives qu’ouvre l’utilisation des données de santé (SNDS) et des bases de données sur l’environnement, mais encore la mobilisation d’autres expertises, notamment sociologiques et historiques.
Des échanges riches favorisant l’émulation entre chercheurs et la mise en place d’une stratégie commune pour :
- Créer de la connaissance, dresser une littérature scientifique précise avec les dernières données sur le rôle de l’environnement.
- Améliorer la prévention: réduire l’augmentation des cas de maladies au sein de la population mais aussi réduire les risques d’aggravation de la maladie diagnostiquée. Avec un encouragement à modifier son environnement et mode de vie : arrêt du tabac, mise en place d’une alimentation la moins transformée possible, pratique d’une activité physique régulière, limitation de l’utilisation d’objets à risques (par exemple les poêles en téflon, les bouteilles en plastique…).
- Améliorer la prise en charge des malades, un défi dans un contexte d’augmentation des cas, notamment chez les plus jeunes, des cas plus sévères et difficiles à traiter. Avec des enjeux de personnalisation du suivi, permettant notamment d’identifier le plus tôt possible le traitement qui aura la meilleure efficacité.
Et bien sûr l’espoir d’une réaction des pouvoirs publics car nous faisons face à un enjeu majeur de santé publique qui appelle à la mise en place de politiques de prévention et de réduction des risques en particulier en matière de pollution et d’alimentation.